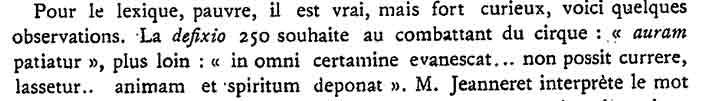Posté par
Robert Geuljans le 15 Juil 2011 dans
a |
0 commentsAura « vent » vient du latin aura « soufle, air, brise ».
Le massacre de la toponymie provençale par les géographes français a conduit à de nombreuses appellations curieuses. Un visiteur me signale: « … près de Toulon, le « baou de l’aure » (le sommet du vent du nord) est devenu le Baou de l’Heure. » (Source ll faut dire que Google ne le connaît pas)). Un autre me signale: dans la série des déformations, on a le chemin du Moulin de Laure à Alès et l’école du Moulin de Laure à Lançon de Provence. Le « molin de l’aura « , en territoire provençal n’est-il pas l’équivalent du « molin de vent » en Languedoc.
Fabien, qui a visité mon site m’écrit le11-10-2016:
A l’article aura, vous mentionnez le baou de l’heure à Toulon. Il s’agit du Baou de 4 Heures, c’est bien le contresens de la traduction du Baou des 4 Vents : Mistrau, Trémount, Labé, Ponant selon une étude de l’Académie du Var de 1976.
Le sens du mot aura s’est généralisé dans les langues romanes. En latin c’était surtout « une brise agréable et rafraichissante ». En galloroman aure, aura désigne tous les vents possibles, de la brise à l’orage, et il fait le tour de la boussole suivant les régions.
Suivant les attestations anciennes le mot a dû exister en langue d’oïl comme en langue d’oc, mais il a été concurrencé par le mot « vent » venant de la région parisienne et n’est plus vivant qu’en franco-provençal et dans l’est du domaine occitan, jusqu’à Trèves et Alzon dans le Gard, et en Lozère. Une autre aire se trouve en Wallonie. (voir la page Fandaou pour une histoire analogue de géolinguistique).
En occitan nous trouvons dès les plus anciens textes une série de dérivés d’aura avec le sens « fou »: Que m vol aitals amors aurane (Que me veut une telle amour légère) Bertrand de Ventadour, (Raynouard I,p. 148); auria adj. avec le même sens. En languedocien moderne on trouve le sens littéral et figuré dans aurat « léger, évaporé; tête au vent, étourdi, imprudent ». En ancien occitan, je trouve une forme qui fait très moderne aurania « légèreté, extravagance ».
D’après le FEW, on peut retracer cette signification dès le latin classique. Par exemple chez Ovide aura veut dire « inconstance ».
Une autre attestation se trouve dans une » tablette d’exécration » ou defixio. J’ai déjà parlé de ces tablettes à propos du mot fan. Je les trouve passionnantes, tellement loin du latin classique que j’ai appris au lycée, le latin d’ Ovide, de Virgile et de Seneca, mais tellement proches des hommes et des femmes qui vivaient dans notre région il y a 20 siècles. Alors j’ai cherché le texte dont le FEW parle et je l’ai trouvé grâce à Gallica. Il s’agit d’un compte-rendu d’un livre de Maurice Jeanneret La langue des tablettes d’exécration latines. Thèse de Neuchâtel, 1918, par J.Jud dans Romania 45, p.500. Les tablettes ont été décrites par Auguste Audollent en 1904 : (A. Audollent, Defixionum tabellae quotquot innotuerunt tam in Graecis Orientis quam in totius occidentis partibus praeter Atticas in corpore inscriptionum Atticarum editas, Thèse de doctorat d’État, Paris, A. Fontemoing, 1904 ; rééd. Francfort, 1967.téléchargeable) Voici une partie du texte de J.Jud :
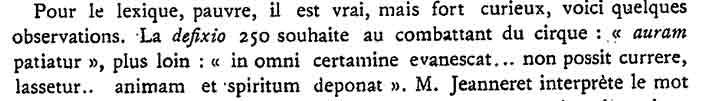 J.Jud discute l’interprétation de M.Jeanneret de auram patiatur et propose de le traduire par « souffrir d’un accès de folie« .
J.Jud discute l’interprétation de M.Jeanneret de auram patiatur et propose de le traduire par « souffrir d’un accès de folie« .
Un sujet passionnant. J’ai réuni des images et des explications: Tablettes d’exécration
 Un exemple pour vous donner envie. Cliquez sur l’image.
Un exemple pour vous donner envie. Cliquez sur l’image.
dans une étroite bande jusqu’à la frontière italienne. En effet l’abbé de Sauvages mentionne abet « sapin, arbre résineux des hautes montagnes à feuilles d’if » (S2). L’ALF confirme pour Alès : abé. Abet est passé dans des dictionnaires français, e.a. celui de Cotgrave (1611) jusqu’au Larousse de 1948 avec la mention « régional ».