Posté par
Robert Geuljans le 15 Sep 2011 dans
m |
0 commentsMor, morre 1) « museau, groin » fait partie d’une grande famille de mots qui vit dans les langues romanes autour de la Méditerranée, par exemple en catalan morro « museau; le devant d’une voiture, d’un avion etc. », fer morros « faire la moue », faire de mourres en occitan, inflar els morros a algu = « casser la gueule à quelqu’un ». D’après Raymond Covès il est très vivant en français régional.
 La répartition géographique de cette famille de mots jusqu’en sarde suggère une origine préromane *murr- d’après le FEW.
La répartition géographique de cette famille de mots jusqu’en sarde suggère une origine préromane *murr- d’après le FEW.
A partir du sens « museau » on arrive facilement à « nez, visage, figure » que nous retrouvons dans les dérivés comme ancien occitan morada « coup sur le museau ». La conséquence d’une morada est qu’on devient morut « qui a de grosses lèvres » (aoc.). Quelqu’un qui fait de mourres est un mouru « bouru, incivil, maussade, d’une humeur sombre et farouche » comme l’écrit l’abbé de Sauvages. En parlant d’un couteau ou d’une aiguille mouru est « émoussé ». Lou bé dë las âoucos ës mouru « le bec des oiseaux est mousse » dit-il.
A Alès le « rouget grondin » est appelé mourudo , à cause du grondement qu’il fait entendre quand il est pris ».
 mourudo
mourudoEt d’après la forme du museau nous avons dans le Gard le moure pounchu « musaraigne », mais à Puisserguier le moure pounchu‘ est un » rychnite de la vigne ». Pour les nombreux dérivés voir Alibert, qui donne entre autres le composé morre ponchut « sparaillon ».


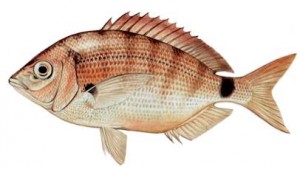
En provençal et est languedocien le moure-pourcin est une plante, le « taraxacum officinalis » appelé ainsi parce que le soir quand la fleur s’est fermée elle ressemble à un groin de porc. L’image contenue dans cette dénomination n’étant plus comprise, le mot a subi les pires traitements phonétiques dans les différents patois, au point d’ aboutir à repounchou à St Afrique par exemple.

Les habitants d’Aigues-Mortes sont appelés les morres pelats « museaux pelés » par les Pérolais. (Achard, p.412)
Voir aussi l’article mourre « colline ».
Dans le Nord de la France et même en moyen néerlandais (morre « museau »), on trouve quelques attestations du type *murr-. Le FEW suppose qu’il s’agit d’emprunts à l’occitan. Il faut admettre qu’en galloroman *murr- est pratiquement limité à l’occitan et au franco-provençal., mais pas ses dérivés et les composés. Je ne suis pas convaincu qu’il s’agit d’emprunts, parce qu’on trouve un mot comme mornifle composé de la même racine *murr- + nifler dans les patois du nord et pas dans le Midi. Un lien avec le germanique murren » grommeler, bouder », néerlandais morren ou au moins une influence sémantique ne me semble pas exclu non plus . En catalan le morro « groin, le museau, la gueule d’ une personne qui fait la gueule » ; et fer morros « bouder » c’est plus que faire la moue,











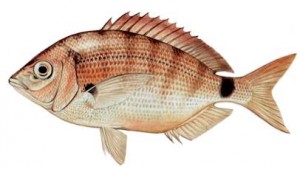

 fabrication de la mortadella
fabrication de la mortadella 