Posté par
Robert Geuljans le 23 Juin 2011 dans
a |
3 commentsAbes, àbet s.m.pl. « balles de blé ou d’autres céréales » (St-Pons, Capestang), abets (Aude, Toulouse), a(w)ets (Hte-Garonne). L’accent est sur le a-. L’origine est un mot latin apex, apicem « sommet, pointe, tout objet de forme conique ». Les attestations sont relativement rares, une vingtaine, et étendues sur une région qui va de l’Hérault au Gers, auxquelles s’ajoutent probablement les mots basques abotz « criblures » et agotz « balle de blé ».

Grâce au commentaire d’un visiteur, une attestation de l’Ariège et une correction importante du sens. Ci-dessous une image d’ abets sur l’andain, et d’autres de balles d’épeautre et de blé :


 Les balles volent!
Les balles volent!
Je me demande toujours comment il a été possible qu’un tel mot latin avec un sens très spécifique a été transmis de génération en génération pendant 20 siècles, dans des villages qui sont tellement éloignés les uns des autres. Mais il est possible que des attestations nous manquent. Si vous connaissez le mot, contactez moi.
Claude Achard a eu la gentillesse de me contacter :
Abets : « Les faibles seront aux abets, c’est-à-dire la balle et les barbes qu’on emporte par gros ballots fort peu pesants » Raymond Escholier, Gascogne.p. 68.
“Àbets, abë, balles de céréales, vannures ; balle de grains, menue paille ; ballot de fourrage ; l’abe dou blad, la balle du blé, celle de l’avoine, voy. poussës ”. (DOUJAT, 18 ; LAGARDE, 21 ; CANTALAUSA, 30 ; de SAUVAGES, I.3 ; MISTRAL, I.6. GARY, 2 ; VESTREPAIN, 303 ; ACADEMIA, 3). Aver la clau dels abets, avoir la clé des menues pailles, ne pas être l’homme de confiance à qui on confie la clé du grenier à blé. (ALIBERT, 65).
Le mot apex a été réintroduit dans le milieu des paléontologues pour désigner le sommet des coquilles de certains fossiles, comme les ammonites. Je vois dans le TLF que cette remarque est la conséquence d’une déformation professionnelle et que apex a beaucoup d’autres significations.


__________________
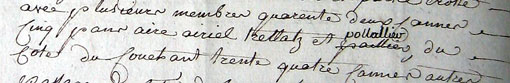







 Les balles volent!
Les balles volent!
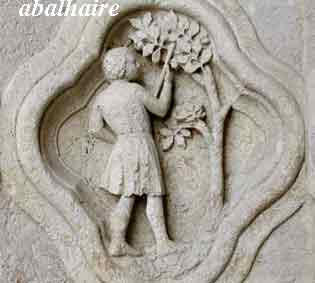 bacular
bacular 

