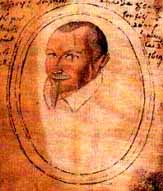Tosela
Tosela « tauselle » orthographié en français également touzelle, tauzelle etc.
Charles Atger « Valleraugue. Petites histoires et anciennes coutumes », Le Vigan 1972 , p.12 écrit :
« La plupart de temps il [le paysan] faisait lui-même le pain du ménage avec la farine du seigle récolté à la ferme. Cette farine était mélangée à celle du froment ou de touzelle, achetée chez le boulanger et cela donnait un pain excellent….
J’ai repris le manuscrit de Seguier1, feuille 41 r.: touselle « lou blad lou pu pesant lou pu beu lou millou et aquel que fait lou pan lou pu blanc de tout lou languedoc ». et un peu plus loin : miscle: « blad mele de touselle et de siguie ».
tosela touzelle
Etymologie : cette image explique l’étymologie du mot : c’est un blé sans barbe autrement dit « tondu », ce qui s’appelait tonsus le part.passé du verbe tondere, avec le suffixe -ellu.
Il s’agit d’un variété de froment cultivé uniquement dans les régions méditerranéennes. Le mot est également occitan, même s’il a été importé en français par Rabelais qui lui, savait de quoi il parlait, ayant fait ses études à Montpellier. Dans le Quart Livre des faits et dits héroïques du bon Pantagruel:
« cestuy home caché dedans le benoitier, aroyt un champ grand & restile, & le semoyt de touzelle « ,
contrairement à Jean de La Fontaine qui utilise le mot également dans : Le Diable de Papefiguière :
Le Manant dit : » Monseigneur, pour le mieux,
Je crois qu’il faut les couvrir de touselle,
Car c’est un grain qui vient fort aisément.
– Je ne connais ce grain-là nullement,
Dit le Lutin. Comment dis-tu ?… Touselle ?…
Mémoire n’ai d’aucun grain qui s’appelle
De cette sorte ! Or emplis-en ce lieu :
Touselle soit, touselle, de par Dieu !
La Fontaine a avoué à Richelet, l’auteur d’un dictionnaire, qu’il ne savoit pas ce que c’était. Pourtant le mot est resté dans les dictionnaires français jusqu’à nos jours avec la graphie tauselle. Enfin dans le TLF on le trouve avec la graphie touselle, touzelle.
Et pour terminer voici ce que l’abbé de Sauvages qui savait de quoi il parlait, a écrit à propos de touzelo,
L’histoire du pain de Gonesse fait uniquement avec de la tauselle, est confirmée dans ce site : . Du XVe au XVIIe siècle, le village se tailla une solide réputation pour la qualité de son pain fabriqué avec le blé du terroir, le pain mollet de Gonesse



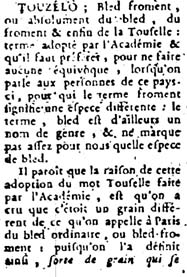
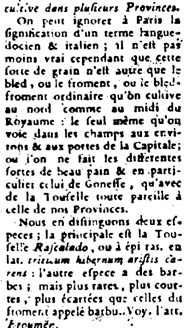
 et en Corrèze :
et en Corrèze :