Posté par
Robert Geuljans le 7 Juin 2012 dans
Lexique occitan |
Commentaires fermés sur Exercer sa mémoire Les étudiants de tout le monde savent très bien que savoir exercer sa mémoire est très importante. La mémoire nous sert pour nous souvenir d’une énorme quantité de choses chaque jour. Mais la mémoire est aussi un moyen indispensable pour l’apprentissage d’une langue étrangère.
Apprendre des nouvelles structures pour former la phrase comporte un effort de technique. Mais se souvenir de chaque mot c’est un travail de la mémoire.
Alors, il faut commencer à faire quelque chose pour améliorer nos capacités de mémoire afin que l’apprentissage de n’importe quelle langue étrangère puisse devenir plus facile et agréable.
Avec cet article nous voulons vous donner des avis pour exercer votre mémoire et trouver la juste méthode pour vous approcher à une langue étrangère.
Il faut savoir que de règle on apprend mieux en lisant qu’en écoutant. C’est pourquoi quand on lise un texte on peut le voir physiquement avec les yeux et on peut s’arrêter à lire deux fois le même mot et à chercher son signifiance sur le vocabulaire. C’est un étudie que en écoutant devient impossible.
Apprendre par cœur est utile en quelque cas, mais il ne doit pas devenir une règle pour affronter une langue étrangère. En fait, la chose important est de comprendre ce qu’on apprendre par cœur. Chez une langue, il faut s’exercer avec la répétition des mêmes mots. Un petit avis d’or est de répéter les mots nouveaux en regardant une image qu’en représente le signifiance : cela vous aidera à associer le signifiance avec l’idée. La mémoire visuelle vous sera de gros aide.
Evitez de choisir des méthodes d’étudie trop mécaniques. L’exercice physique est bon pour votre cerveau, mais souvenez-vous que la mémoire fonctionne de même façon qu’un être vivante. Les capacités cognitives peuvent trouver dans la gymnastique du cerveau un moyen très utile pour s’améliorer beaucoup.
La mémoire est très souvent considérée comme s’elle fuisse un muscle du corps. On l’entrainer pour la développer. Commencez avec peu de mots par jour et augmentez la quantité de mots à apprendre en façon graduelle.
Il faut aussi savoir que tous n’ont pas la même capacité de mémoire : il y ont des personnes qui peuvent se souvenir de plus choses que les autres. Pourquoi ?
Les raisons sont de nombreuses. Avant tout, la mémoire de chacun dépende d’une grosse quantité de facteurs différents, comme par exemple les influences génétiques, la bonne santé (la maladie de l’Alzheimer est un facteur qui cause des graves dommage à la mémoire), l’âge, l’alimentation, un environnement stimulant, le stress et même l’humeur et l’estime de soi.
Les facteurs ci-dessus ne dépendent pas de nous et de notre volonté. Mais il y a aussi un nombre d’autre facteurs sur lesquels on peut faire quelque chose. Ils sont l’attention, la concentration, la motivation à apprendre une langue étrangère, l’attitude positive et l’organisation des matériaux dans notre cerveau. Tous ces facteurs peuvent trouver un énorme bienfait par les exercices cérébraux.
En général, on peut exercer sa mémoire à travers des exercices très différents. Par exemple, les sudoku sont une façon pour améliorer les capacités de calcule et de mémoire. Mais les jeux enligne aussi sont un moyen très utile pour aider notre mémoire.
Chaque fois que nous devons nous souvenir d’un résultat de jeu ou de la valeur de nos cartes de poker, en réalité, nous ne faisons rien d’autre que d’exercer notre mémoire.
Les jeux de casino chez http://www.eurokingcasino.info sont tous bien mis à jour et amusants. Si vous ne voulez pas jouer pour de vrai, pas de problème, car on peut choisir la modalité de jeu pour simplement vous amuser en gratuit. Vous aurez droit à jouer à tous les jeux sans devoir payer un dépôt au casino.





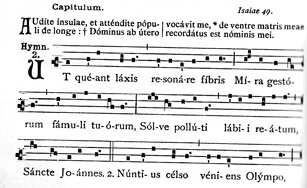
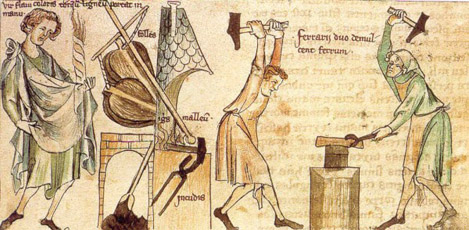 faures
faures


