Esfata, esfataire
Esfata, « défricher », cf.fataire.
Esfataire, « celui qui déchire, défriche » cf. fataire.

Esfata, « défricher », cf.fataire.
Esfataire, « celui qui déchire, défriche » cf. fataire.
Esfougassà, « aplati » cf. fougasso
Esglaja « effrayer » est un dérivé de l’ancien occitan glai s.m. « effroi » (XIIIe s.). La famille de mots dont esglaja est surtout attestée à l’Est du Rhône et se retrouve dans les parlers du Nord de l’Italie.
L’étymologie d’esglaiar, un dérivé de gladius « épée », demande un commentaire. Le verbe esglaiar signifie en ancien occitan » tuer avec une arme », mais aussi « effrayer, intimider ». C’est ce dernier sens qui a survécu en provençal. L’explication de l’emploi au figuré de glai « épée » donnée par von Wartburg (FEW) se trouve dans l’Evangile où gladius est utlisé pour décrire la douleur et l’effroi de la Vierge à la mort du Christ. Par exemple dans Lucas 2.35 : et tuam ipsius animan pertransibit gladius.
A partir du pluriel gladii > gladî a été formé le substantif glazi « épée » en ancien occitan, et nous trouvons le même emploi au figuré dans les dictionnaires de l’occitan moderne comme dans le verbe glasí « effrayer » (Gers), esglariat « effaré, emporté, hors de soi » (Marseille) et eglaria donné par l’abbé de Sauvages (S2).
Dans les dialectes du Nord et en français jusqu’à la fin du XVIIe s, glai prend le sens du dérivé latin gladiolus « glaieul », qui a donné glooujou, glaujou, glauïol en occitan, néerlandais gladiool, allemand Gladiole.
Pour une explication de la forme glaive « épée » dans la langue d’oïl, et en anglais voir le TLF.
èso « corsage près du corps du costume des Arlésiennes ». Étymologie : latin adjacens « qui est proche ». FEW XXIV,144 J’y reviendrai pour expliquer l’évolution sémantique.
Dans le blog Nadine de Trans en Provence j’ai trouvé une description et une belle photo de l’èso de l’Arlésienne:
Mistral nous fournit deux définitions: 1. grand linge et 2. corsage.
Bourilly Joseph, La vie populaire dans les Bouches-du-Rhône. Marseille, impr. Barlatier , 1921 décrit la capello et l’éso :
Mon ami Michel Fournier source inépuisable de renseignements sur le provençal m’écrit:
l‘eso est bien le corsage ou caraco, très ajusté, très près du corps, il est généralement de couleur noire, avec une jupe d’autres couleurs. Pour les tenues très habillées, l’eso est du même tissus que la jupe.
La chapelle ou « devant d’estomac » est une pointe plus ou moins riche de dentelles blanches qui s’épingle devant sur le caraco et que vient border le fichu plissé.
La chapelle, par ce qu’il permettait aux arlésiennes qui portaient une croix moins riche , de porter aussi, dissimulé sous la pointe de dentelles, de petits reliquaires.
L’évolution sémantique de èso.
Dans la Chanson de Sainte Foy (première moitié du XIe siècle) le mot aitz isssu du latin adjacens signifie « région, pays, endroit ». Un peu plus tard aussi « demeure, habitation ». Quand on est dans son habitation on se sent à l’aise et le mot aise prend dans des expressions comme esser, estar, tener, viure ad ais le sens « à l’aise, dans un état de bien‑être [matériel, physique ou moral » (Voir le Dictionnaire Occitan Mediéval s.v. aitz pour l’importante discussion de cette étymologie et la riche documentation! ).
Les Arlésiennes se sentent probablement très à l’aise dans leur èso. Cela doit aussi être valable pour le premier sens donné par Mistral.
Capello ou chapelle « partie des vêtements des Arlésiennes qui couvre les seins » d’après Auguste Brun1 vient d’après le FEW III, 286 du latin cappella « petit manteau »,un mot qui a en effet pris de nombreux sens plus ou moins techniques.
Espanir « sevrer ». L’étymologie a été décrite par Antoine Thomas dans son Mélanges d’étymologie française. Paris, 1902. que j’ai retrouvé grâce à Lexilogos. Ci-dessous je copie la page
D’après le données du Thesoc espanir a été conservé dans la CREUSE, DORDOGNE, HAUTE-VIENNE, VIENNE. En cliquant sur ce lien vous verrez aussi que la note 4) de Thomas est toujours valable.
Le FEW 17, 165 rassemble dans le second article *spannjan « sevrer » (ancien francique) toutes les données connues en 1962. Le verbe espanir est attesté en ancien français depuis le XIIe siècle et en ancien limousin depuis le XIVe. On le trouve surtout dans les parlers picards, flamands, wallons et lorrains, ensuite par-ci par-là dans l’ouest de l’occitan; mais le FEW n’a pas non plus de réponse à la question que Thomas déjà posait : quel est le lien entre le verbe occitan espanir et le verbe wallon?
Le verbe *spannjan « sevrer » fait partie d’une famille de mots très répandue dans les langues germaniques; néerlandais speen « téton, tétine », spenen « sevrer », allemand Spanferkel « cochon de lait ».
D’après l’ EWN il y a un lien avec l’ancien irlandais sine (< *spenio) ‘téton’; < pie. *spen-, *span- ‘tétine, sein, téton’ (IEW 990). Comme on n’arrive pas à expliquer un lien avec le francique, il faudra peut-être penser au gaulois? Si vous connaissez un mot de la même famille dans une langue celtique contactez-moi ou laissez un commentaire.
Espantar « épouvanter, surprendre, impressionner, étonner ». Tu m’espante! en français régional. Espantar a la même étymologie que français épouvanter. latin *expaventare qui n’est pas attesté mais qui a dû être formé très tôt en latin parlé puisqu’on le retrouve en italien spaventare, en catalan, espagnol et portugais espantar. Les formes espand, espantable ont également existé en ancien et moyen français :
Nouveau et important: Voir le Dictionnaire du Moyen Français (DMF) ! avec de nombreux exemples, des liens, bibliographie, les etyma, etc. Vous arriverez sur la page où la recherche se fait à partir d’un étymon. Pour *expaventare cliquez dans la première ligne sur E, dans la deuxième ligne sur X et dans la troisième sur P, ensuite choisissez *expaventare. Vous trouverez les 38 articles.
En occitan moderne et en français régional le sens s’est plus ou moins affaibli par l’ usure comme cela arrive souvent aux mots expressifs. D’autre part espanter devient de plus en plus courant dans des blogs, forums etc.
En occitan moderne on trouve à côté des formes espantar des formes avec –v- : espaventá, espraventá, espabenta, qui sont probablement refaits à partir du substantif espavent « épouvantail ». Voir aussi le Thésoc, s.v. « épouvantail » pour l’ouest-occitan. En provençal comme dans des localités du Gers, Haute-Garonne et des Hautes- Pyrénées on trouve un autre dérivé en ale : espaventau.
Emprunté au français: breton spount et spoñtus « épouvantable ».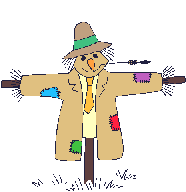
Esparcel » sainfoin. » l’Étymologie est le participe passé latin sparsus du verbe spargere « répandre ». L’explication de cette étymologie se trouve dans le fait que l’esparcel est semé à la volée.
Christine Becikowski a consacré un article au Manuel d’agriculture et de ménagerie, avec des considérations politiques, philosophiques & mythologiques, dédié à la patrie, par le citoyen Fontanilhes, à Toulouse, de l’imprimerie de la citoyenne Desclassan, 1794-1795. Fontanilhes se proposait d’instruire ses lecteurs du moyen d’augmenter la production agricole en France, et plus spécialement en Ariège et en Haute-Garonne. Il utilise (consciemment ?) plusieurs mots issus de l’occitan que l’on peut considérer comme du français régional, dont esparcel.
C’est l’agronome Olivier de Serres originaire de l’Ardèche qui a introduit le nom esparcet en français au XVIe siècle.
Voir FEW XII,134b
Espargoule « pariétaire; asperge » vient d’un latin médiéval des botanistes spergula « plante du genre Galium« (?). Les botanistes du Moyen Âge, qui étaient en général médecins et pharmaciens, ont latinisé le mot provençal espargoulo un dérivé du latin asparagus « asperge ». Le nom espargoulo est limité au provençal + le département du Gard, attesté notamment à Saint-André de Valborgne. Voir Le FEW XXV, 464 pour les attestations, colonne à gauche, à partir de 2aα. En languedocien espargola, espargou(l) désigne « l’asperge » ! Attestations dans la même page, en bas à partir de 2aβ.
L’histoire de ce mot provençal se trouve à la page 466 et est rédigée en FRANÇAIS. Il suffit de cliquer sur le lien !
 pariétaire
pariétaire  pariétaire.
pariétaire.  asperge sauvage
asperge sauvage
Spergula a été adopté par Linné (1753) comme nom d’un genre de plantes herbacées de la famille des Caryophyllacées. (Wikipedia)
Espatarrar (s’) « s’étendre de tout son long, écarquiller les jambes, se mettre à l’aise ». s’espatarrer en français régional (Midi Libre juillet 2005).
Alibert donne comme étymologie : Occitan es + pata + ar, mais sans spécifier de quelle pata il s’agit. En occitan il y a pata « patte » mais aussi pata « chiffon » et il n’ont pas la même étymologie. Je pense qu’il s’agit du second : pata « chiffon » qui fait partie d’une famille de mots vivant dans le nord de l’Italie, par exemple piémontais pata « chiffon », en rhétoroman ainsi que dans le sud-est du galloroman et en Lorraine.
Espeisses, Bois des – . Nom du poumon vert et lieu de promenade de Nîmes. Etymologie.
Espeisses vient du latin spissus « épais, touffu, gros »; utilisé comme substantif spissus prend le sens « fourré, broussailles », synonyme de garrigue dans notre région. Pégorier donne Espesse « bois touffu » en ancien français.
Le Bois des Espeisses

Au Nord-ouest de la ville, à moins de deux kilomètres du centre, ce site boisé de 83 hectares est considéré comme le « poumon vert » de Nîmes. Quatre parcours découverte, fléchés et balisés sont proposés aux promeneurs. Cliquez!
Le mot Bois dans le nom actuel Bois des Espeisses a une histoire spéciale. La première mention date de 1144, d’après le dictionnaire topographique de Germer-Durand : Divisia d’Espeissal. La graphie change au cours des siècles : Devesia de Speissas en 1195 > Devesia de Espeissas en 1463 > Devois des Espeisses en 1671 > Les Espeisses en 1704 > Bois des Espeisses sive Puech Mazel, Puech Mézel en 1706.
Le nom Bois est très récent. Avant le XVIII siècle le nom dans la langue parlée était Devois, Debois, en languedocien v et b sont confondus. Dans les textes en latin nous trouvons Devesia. La forme Devois est une francisation de Devesia ( le –e- long latin devient -oi- en français). Les plus anciennes attestations Divisia, devesia sont une latinisation de la forme occitane deveza « terrain réservé » qui vient du latin defensum « interdiction » (voir ci-dessous), que le premier copiste a compris comme ancien occitan deviza « division », dérivé d’un verbe *divisare « partager ».
Devèze, devèse; deveso, debes en Rouergue, defès en Périgord, est un toponyme très courant; voir par ex. pour le Gard Germer-Durand. Ancien occitan deveza signifie « terrain réservé ». D’après Pégorier devèse s.f. « défens, réserve, jachère, friche » dans les noms de lieux. Dans l’Aude (cf. Thesoc) et le Cantal debezo « jachère », dans le Cahors debéso « pâturage ». La forme féminine est limitée à l’occitan et désigne le plus souvent une jachère. L’étymon est latin defensum « interdiction » > ancien occitan deves.
La devèse était une jachère, du terrain où le bétail ne pouvait paître qu’avant le labourage et qui lui était interdit après cette période de l’année.
Conclusion : une mauvaise interprétation au XII siècle du mot occitan Devese a abouti au nom actuel Bois des Espeisses.
Puech Mazel, Puech Mézel. La remarque dans le Dictionnaire topographique du Gard, m’a poussé à jeter un coup d’oeil à ce nom : « Montagne commune de Nîmes, dans le bois des Espeisses. Première attestation date de 1144 : Medium leprosum c’est-à-dire le « domaine des lépreux », plus tard le Medium Mezel et depuis 1596 le Puech Mazel. A partir d’ici, c’est aux historiens de révéler l’histoire.